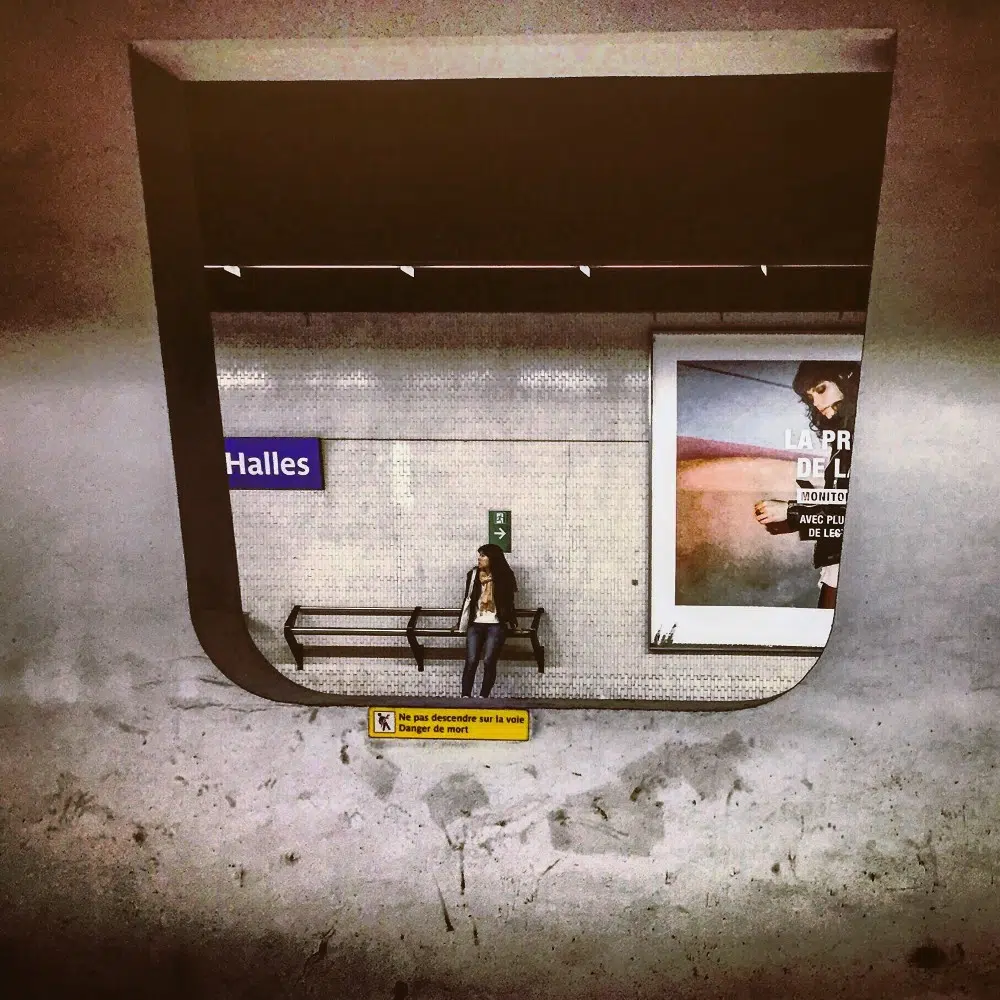180 centimètres de tissu, une étiquette griffée “unisexe” et l’industrie croit avoir résolu la question du genre. Pourtant, derrière les vitrines épurées et les slogans sur la diversité, la réalité s’accroche encore à des modèles hérités : pantalon droit, chemise boxy, t-shirt large et neutre. Les grandes enseignes affichent leurs collections “genderless”, mais la coupe, la taille, la grille de mesures ? Toujours calquées sur le modèle masculin. Les textes européens, eux, continuent de classer les tailles selon des morphologies typées “homme” ou “femme”, un carcan qui bride la création inclusive.
Face à ces contraintes, de jeunes marques, souvent indépendantes, explorent d’autres voies : systèmes de tailles repensés, vêtements modulaires, patronages ajustables. Mais la route est semée d’obstacles : coûts de production, logistique artisanale, faible volume de vente. Malgré des clients de plus en plus demandeurs, la filière textile hésite encore à s’aventurer hors des sentiers battus du genre binaire.
Comprendre la mode inclusive : entre unisexe, non genré et diversité des identités
La mode inclusive s’émancipe désormais des dualités classiques. Elle s’attaque au cœur du problème : la façon dont le vêtement invisibilise certaines morphologies et identités. À Paris comme à Berlin ou New York, des stylistes remettent à plat le rapport au corps : coupe, taille, matière, chaque détail compte pour créer des vêtements non genrés qui accueillent la pluralité. On s’éloigne du t-shirt large estampillé “unisexe” ; la réflexion s’ancre dans la réalité des corps, loin des normes héritées.
Si les vêtements unisexes ont ouvert la voie, ils ont longtemps perpétué des standards masculins, occultant la richesse des silhouettes. Aujourd’hui, la mode inclusive reconnaît que l’identité de genre ne se limite pas à deux cases. Elle s’inspire de la dynamique body positivity pour inventer des coupes ajustables, des tailles qui ne s’arrêtent plus au 44, des vêtements qui s’adaptent à chacun, pas l’inverse. L’objectif : que chaque personne se voie dans le vestiaire, sans devoir choisir entre “pour homme” ou “pour femme”.
Voici les axes majeurs qui guident cette transformation :
- Représenter toutes les morphologies : la création s’ouvre à la diversité des corps, sans restriction unilatérale.
- Respecter les identités : chaque vêtement vise à englober toutes les expressions de genre, sans hiérarchie ni exclusion.
- Repenser les normes : l’inclusivité questionne l’articulation entre vêtement, genre et estime de soi.
La diversité corporelle ne relève plus du vœu pieux : elle s’impose comme une exigence portée par de plus en plus de marques, en France et ailleurs. La mode inclusive sort du cercle fermé, rebat les cartes et interroge tout ce qui structurait jusqu’ici l’offre textile : codes du genre, logiques de coupe, représentations dans la publicité.
Pourquoi l’inclusivité dans le vêtement transforme-t-elle notre rapport au genre ?
Exprimer qui l’on est, affirmer son identité ou simplement s’habiller selon son envie : la mode non genrée bouleverse la donne. Enfiler une chemise ample ou choisir des chaussures pensées sans distinction de genre, ce n’est plus seulement une question d’esthétique. C’est le droit de s’extraire des assignations, de décider de l’image que l’on présente au monde. Le vêtement, longtemps utilisé pour distinguer hommes et femmes, devient le terrain d’une autodétermination réelle.
Les créateurs axent leurs efforts sur la prise en compte des morphologies réelles et sur le confort. Finis les patronages figés, pensés pour des silhouettes standard. Place à la flexibilité : coupes adaptables, textiles qui accompagnent les mouvements, tailles qui cessent de s’arrêter au XL. Les couleurs s’affichent discrètes ou affirmées, mais toujours hors de la binarité. Le vestiaire gagne en souplesse, en largeur, en possibilité.
Vers une nouvelle grammaire stylistique
Plusieurs exemples marquants illustrent cette mutation :
- Chaussures non genrées : conçues pour toutes les morphologies, elles misent sur l’aspect pratique et le confort, sans sacrifier l’allure.
- Styles personnalisables : chacun compose son look, selon ses propres codes, loin des injonctions d’un genre imposé.
Des icônes comme David Bowie ou Marlene Dietrich ont longtemps brouillé les pistes, jetant les bases d’une mode sans frontière. Leur audace fait écho, aujourd’hui, à une génération qui refuse de choisir entre le masculin et le féminin. La mode inclusive ne propose pas une simple alternative : elle remet le vêtement au centre de la liberté individuelle, accessible à tous.
Défis et enjeux pour les marques face à la création de collections non genrées
Lancer une collection non genrée relève du défi industriel. Adapter la coupe d’un blazer, élargir les grilles de tailles, choisir des tissus qui conviennent à toutes les silhouettes : chaque étape bouscule les schémas hérités. Les femmes aux formes généreuses restent souvent absentes des rayons inclusifs, malgré l’essor du marché grande taille. Certaines marques, telles que Elena Mirò, Marina Rinaldi ou ASOS Curve, amorcent pourtant un virage, élargissant leur offre à de nouvelles morphologies.
D’autres précurseurs comme Sumissura ou Hockerty cassent les codes avec des costumes sur mesure, pensés pour tous les genres. Telfar et Collina Strada brouillent les frontières traditionnelles, tandis que Gucci, Versace ou Christian Siriano proposent des pièces adaptées à une multiplicité d’identités et de silhouettes, bien loin du simple argument “unisexe”.
La fabrication de vêtements non genrés suppose de dialoguer avec un public varié. Les influenceurs curvy, en partageant leurs expériences, poussent l’industrie à élargir ses standards. Le changement ne se joue pas uniquement sur les motifs ou les tailles : il s’agit de repenser les habitudes de production, d’oser l’innovation textile et d’attribuer un sens concret à l’inclusivité.
Vers une mode qui questionne et redéfinit les normes socioculturelles
Instagram, TikTok : ces plateformes deviennent des caisses de résonance pour l’inclusivité et la diversité corporelle. Les campagnes publicitaires affichent désormais des corps pluriels, des identités multiples. Le hashtag #bodypositivity, omniprésent, secoue les habitudes et renouvelle les imaginaires. La mode inclusive y trouve son espace d’expérimentation, chaque publication pouvant devenir un acte militant en faveur d’un vestiaire affranchi des cases et des stéréotypes.
La personnalisation s’impose comme une tendance durable. L’intelligence artificielle se glisse dans les ateliers : modélisation 3D, scan corporel, création de vêtements sur mesure. L’enjeu : rendre l’offre vraiment adaptable à toutes les morphologies, à toutes les identités. Loin du prêt-à-porter de masse, la technologie favorise l’accès au vêtement inclusif, sans discrimination.
La durabilité s’imbrique dans cette dynamique. Refuser la fast fashion, c’est aussi défendre une mode responsable, soucieuse de son empreinte écologique et de ses conditions de fabrication. Les jeunes créateurs et les grandes maisons s’engagent : collections éthiques, matériaux durables, attention portée à l’humain. L’inclusivité, ici, ne s’arrête pas au genre : elle s’étend à la planète et à tous ceux qui la peuplent.
Demain, le vêtement inclusif ne sera plus une exception ni un slogan. Il s’imposera comme une évidence, une possibilité en plus sur le portemanteau, pour habiller sans assigner, pour représenter sans exclure. Qui sait quel visage prendra la mode, quand chacun pourra enfin s’y retrouver ?